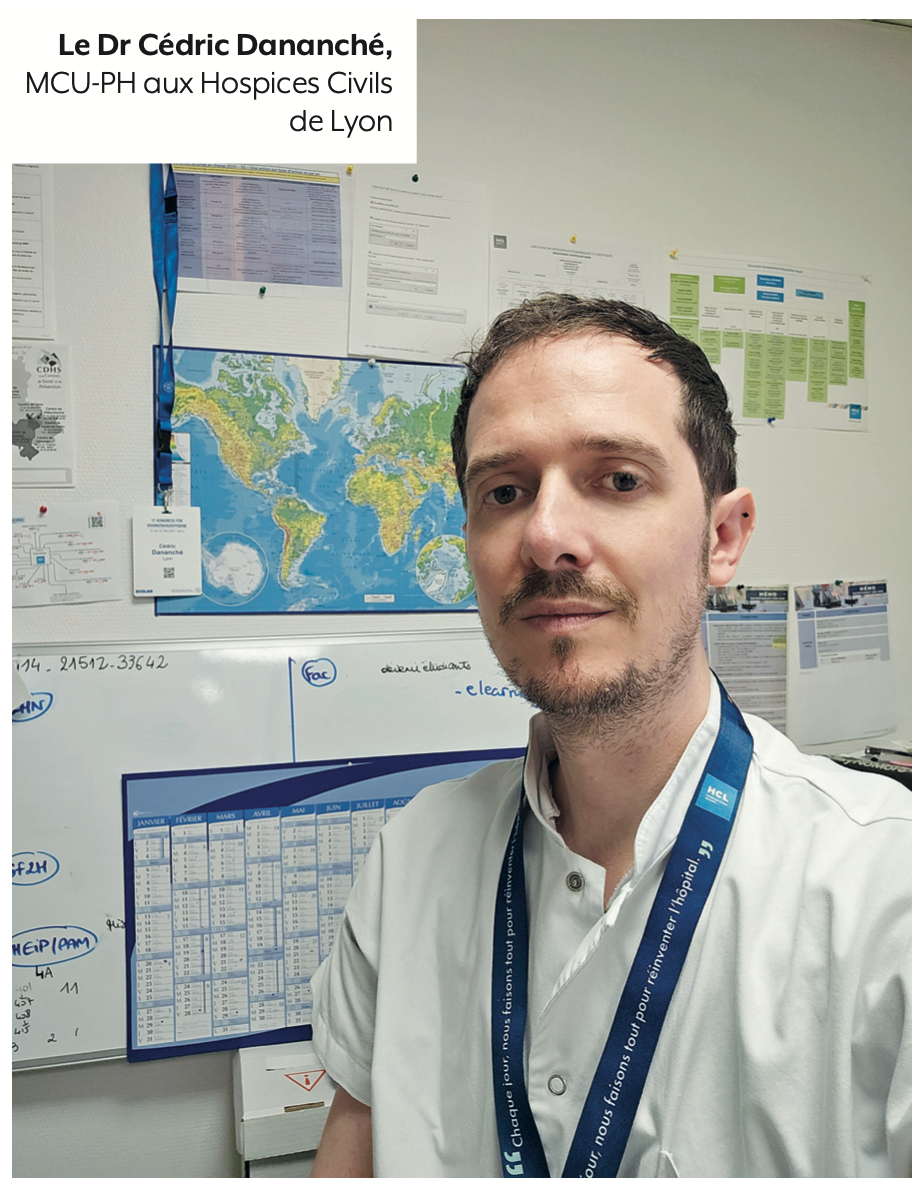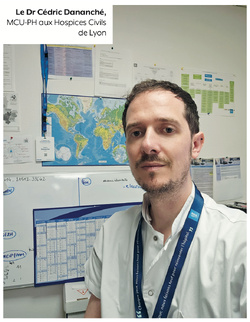Vous combinez activité hospitalière et universitaire. Pourriez-vous nous en parler ?
Dr Cédric Dananché : En tant que MCU-PH, j’ai effectivement une activité hospitalière au sein des HCL, principalement sur le Groupement Hospitalier Nord, qui comprend l'Hôpital de la Croix-Rousse, l'Hôpital Pierre Garraud et l'Hôpital Frédéric Dugoujon. Mon travail s’articule essentiellement autour de la gestion du risque infectieux dans ces trois hôpitaux. J’assure également la coordination du SHEIP, dirigé par le Pr Philippe Vanhems et constitué des équipes opérationnelles d’hygiène (EOH) des cinq groupements des HCL. Sur le plan universitaire, mes recherches portent surtout sur le risque infectieux lié à l’environnement, ainsi que sur la transmission des agents infectieux par voie respiratoire, dans la lignée des travaux du Pr Vanhems, une des figures de référence dans ce domaine. Ce domaine d’étude m’a notamment permis de contribuer à la mise à jour des recommandations pour la prévention de la transmission respiratoire de la SF2H, publiées en octobre 2024.
Quels sont vos axes de travail actuels ?
Mes sujets de recherche actuels comprennent les liens entre taux de CO2 ambiant et transmissions nosocomiales de virus respiratoires. J’explore également l’apport de l’intelligence artificielle pour identifier les facteurs de gravité des pathologies respiratoires. Enfin, je m’intéresse particulièrement au lien entre qualité du bionettoyage dans les hôpitaux et acquisition de bactéries résistantes aux antibiotiques. En parallèle, j’enseigne la santé publique, avec l’objectif de permettre aux étudiants en médecine de développer leur esprit critique, enjeu d’autant plus essentiel face à la montée de la désinformation ces dernières années. Je leur apprends notamment à distinguer corrélation et causalité, une erreur classique d’interprétation souvent réalisée dans les médias grand public.
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur l’exercice hospitalier ?
Celui-ci s’est profondément transformé depuis la crise Covid. Notre discipline a gagné en visibilité, et la prévention du risque infectieux s’est ancrée sur le terrain. Les équipes opérationnelles d’hygiène sont désormais connues et sollicitées par une grande variété d’interlocuteurs : services cliniques, directions fonctionnelles, unités techniques et administratives, cuisine hospitalière, blanchisserie, etc. Pour autant, les mesures de prévention du risque infectieux ne restent pas forcément bien comprises, dans un contexte où il existe de plus une forte rotation de professionnels et un sous-effectif certain. Sans oublier les alertes sanitaires qui se succèdent depuis la crise Covid.
Par exemple ?
En mai 2022, nous avons fait face à l’épidémie de Monkeypox, ce qui nous a contraints, en collaboration étroite avec les infectiologues, à adapter rapidement les circuits de prise en charge hospitalière. L’Hôpital de la Croix-Rousse est d’ailleurs l’Établissement de Santé de Référence Régional (ESRR) pour les risques infectieux émergents ou ré-émergents. Depuis, nous observons une recrudescence d’autres pathogènes, comme la coqueluche et les mycoplasmes. Aujourd’hui, de nouvelles menaces se présentent, notamment la grippe aviaire H5N1 et l’émergence de Candida auris probablement due au réchauffement climatique. Nous devons également composer avec le retour de maladies bien connues et pour lesquelles une protection vaccinale existe, comme les méningocoques ou la rougeole importée du Maroc. Depuis 2020, notre travail de terrain s’intensifie.
Le travail d’un hygiéniste est-il un éternel recommencement ?
Les menaces sanitaires évoluent sans cesse, mais nos méthodes de réponse aussi. Nous sommes d’autant plus contraints de revoir nos manières de travailler que le contexte actuel ne favorise pas une augmentation de nos moyens. Nous devons nous réinventer et nous adapter en permanence, innover dans nos méthodes pour répondre à des besoins évolutifs, tout en préservant nos équipes. Nous sommes en outre confrontés à de nouveaux défis, liés à l’évolution de la perception du risque infectieux par les soignants et les patients.
La crise Covid a pourtant permis des avancées en la matière…
Oui, mais elles s’estompent avec le temps. Pour susciter un véritable changement des comportements, nous nous inspirons des techniques de psychologie sociale. L’approche paternaliste n’est plus audible. Aussi, plutôt que d’adopter une approche directive, nous encourageons l’engagement personnel et la responsabilisation. Nous incitons nos interlocuteurs à réfléchir et à interroger leurs propres représentations du risque infectieux et de sa prévention. Nous utilisons également des outils ludiques, comme la pédagogie par simulation, afin de mieux faire passer nos messages et instaurer un climat de confiance. Et cela fonctionne : là où ils nous percevaient auparavant comme des « empêcheurs de tourner en rond », les soignants soulignent aujourd’hui notre capacité à rechercher le compromis pour proposer la solution la mieux adaptée à leurs contraintes.
Qu’entendez-vous par là ?
La prévention du risque infectieux peut être extrêmement stricte ou plus flexible, mais elle repose toujours sur une approche probabiliste. Nous nous appuyons sur des méthodes de gestion des risques pour déterminer le niveau de contrainte nécessaire. Cette recherche d’équilibre est fondamentale dans le cadre de l’exercice hospitalier. Dans cette même optique, nous questionnons en permanence nos priorités pour nous adapter rapidement aux enjeux actuels. Cela afin de pouvoir continuer à proposer des actions pertinentes, sans nous enfermer dans des tâches à faible valeur ajoutée. Vous l’aurez compris, notre discipline impose une grande agilité, que l’on retrouve d’ailleurs aussi dans notre capacité à dialoguer avec tous les corps de métiers, pour comprendre leurs problématiques et adapter notre langage. L’hygiéniste hospitalier est un vrai caméléon !
Un mot, pour finir, sur la Commission Internationale que vous pilotez pour la SF2H ?
Il s’agit de promouvoir les positions scientifiques de la SF2H sur la scène internationale, et d’entretenir des liens avec nos homologues étrangers. Ces collaborations s’appuient principalement sur le réseau EUNETIPS, qui regroupe plusieurs sociétés savantes européennes engagées dans la prévention et le contrôle des infections. Si les problématiques sont fondamentalement similaires d’un pays à l’autre, les structures organisationnelles varient. Dans des systèmes fédéraux comme l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie, chaque région peut disposer de sa propre politique sanitaire, et parfois de sa propre société savante. Ces échanges sont donc essentiels pour confronter nos approches, les enrichir et améliorer la prévention du risque infectieux à une échelle plus large. D’ailleurs, en agissant au niveau national, et en rassemblant des professionnels médicaux et paramédicaux, la SF2H se distingue en Europe par son organisation unique, qui constitue une véritable richesse.
> Article paru dans Hospitalia #69, édition de mai 2025, à lire ici
Dr Cédric Dananché : En tant que MCU-PH, j’ai effectivement une activité hospitalière au sein des HCL, principalement sur le Groupement Hospitalier Nord, qui comprend l'Hôpital de la Croix-Rousse, l'Hôpital Pierre Garraud et l'Hôpital Frédéric Dugoujon. Mon travail s’articule essentiellement autour de la gestion du risque infectieux dans ces trois hôpitaux. J’assure également la coordination du SHEIP, dirigé par le Pr Philippe Vanhems et constitué des équipes opérationnelles d’hygiène (EOH) des cinq groupements des HCL. Sur le plan universitaire, mes recherches portent surtout sur le risque infectieux lié à l’environnement, ainsi que sur la transmission des agents infectieux par voie respiratoire, dans la lignée des travaux du Pr Vanhems, une des figures de référence dans ce domaine. Ce domaine d’étude m’a notamment permis de contribuer à la mise à jour des recommandations pour la prévention de la transmission respiratoire de la SF2H, publiées en octobre 2024.
Quels sont vos axes de travail actuels ?
Mes sujets de recherche actuels comprennent les liens entre taux de CO2 ambiant et transmissions nosocomiales de virus respiratoires. J’explore également l’apport de l’intelligence artificielle pour identifier les facteurs de gravité des pathologies respiratoires. Enfin, je m’intéresse particulièrement au lien entre qualité du bionettoyage dans les hôpitaux et acquisition de bactéries résistantes aux antibiotiques. En parallèle, j’enseigne la santé publique, avec l’objectif de permettre aux étudiants en médecine de développer leur esprit critique, enjeu d’autant plus essentiel face à la montée de la désinformation ces dernières années. Je leur apprends notamment à distinguer corrélation et causalité, une erreur classique d’interprétation souvent réalisée dans les médias grand public.
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur l’exercice hospitalier ?
Celui-ci s’est profondément transformé depuis la crise Covid. Notre discipline a gagné en visibilité, et la prévention du risque infectieux s’est ancrée sur le terrain. Les équipes opérationnelles d’hygiène sont désormais connues et sollicitées par une grande variété d’interlocuteurs : services cliniques, directions fonctionnelles, unités techniques et administratives, cuisine hospitalière, blanchisserie, etc. Pour autant, les mesures de prévention du risque infectieux ne restent pas forcément bien comprises, dans un contexte où il existe de plus une forte rotation de professionnels et un sous-effectif certain. Sans oublier les alertes sanitaires qui se succèdent depuis la crise Covid.
Par exemple ?
En mai 2022, nous avons fait face à l’épidémie de Monkeypox, ce qui nous a contraints, en collaboration étroite avec les infectiologues, à adapter rapidement les circuits de prise en charge hospitalière. L’Hôpital de la Croix-Rousse est d’ailleurs l’Établissement de Santé de Référence Régional (ESRR) pour les risques infectieux émergents ou ré-émergents. Depuis, nous observons une recrudescence d’autres pathogènes, comme la coqueluche et les mycoplasmes. Aujourd’hui, de nouvelles menaces se présentent, notamment la grippe aviaire H5N1 et l’émergence de Candida auris probablement due au réchauffement climatique. Nous devons également composer avec le retour de maladies bien connues et pour lesquelles une protection vaccinale existe, comme les méningocoques ou la rougeole importée du Maroc. Depuis 2020, notre travail de terrain s’intensifie.
Le travail d’un hygiéniste est-il un éternel recommencement ?
Les menaces sanitaires évoluent sans cesse, mais nos méthodes de réponse aussi. Nous sommes d’autant plus contraints de revoir nos manières de travailler que le contexte actuel ne favorise pas une augmentation de nos moyens. Nous devons nous réinventer et nous adapter en permanence, innover dans nos méthodes pour répondre à des besoins évolutifs, tout en préservant nos équipes. Nous sommes en outre confrontés à de nouveaux défis, liés à l’évolution de la perception du risque infectieux par les soignants et les patients.
La crise Covid a pourtant permis des avancées en la matière…
Oui, mais elles s’estompent avec le temps. Pour susciter un véritable changement des comportements, nous nous inspirons des techniques de psychologie sociale. L’approche paternaliste n’est plus audible. Aussi, plutôt que d’adopter une approche directive, nous encourageons l’engagement personnel et la responsabilisation. Nous incitons nos interlocuteurs à réfléchir et à interroger leurs propres représentations du risque infectieux et de sa prévention. Nous utilisons également des outils ludiques, comme la pédagogie par simulation, afin de mieux faire passer nos messages et instaurer un climat de confiance. Et cela fonctionne : là où ils nous percevaient auparavant comme des « empêcheurs de tourner en rond », les soignants soulignent aujourd’hui notre capacité à rechercher le compromis pour proposer la solution la mieux adaptée à leurs contraintes.
Qu’entendez-vous par là ?
La prévention du risque infectieux peut être extrêmement stricte ou plus flexible, mais elle repose toujours sur une approche probabiliste. Nous nous appuyons sur des méthodes de gestion des risques pour déterminer le niveau de contrainte nécessaire. Cette recherche d’équilibre est fondamentale dans le cadre de l’exercice hospitalier. Dans cette même optique, nous questionnons en permanence nos priorités pour nous adapter rapidement aux enjeux actuels. Cela afin de pouvoir continuer à proposer des actions pertinentes, sans nous enfermer dans des tâches à faible valeur ajoutée. Vous l’aurez compris, notre discipline impose une grande agilité, que l’on retrouve d’ailleurs aussi dans notre capacité à dialoguer avec tous les corps de métiers, pour comprendre leurs problématiques et adapter notre langage. L’hygiéniste hospitalier est un vrai caméléon !
Un mot, pour finir, sur la Commission Internationale que vous pilotez pour la SF2H ?
Il s’agit de promouvoir les positions scientifiques de la SF2H sur la scène internationale, et d’entretenir des liens avec nos homologues étrangers. Ces collaborations s’appuient principalement sur le réseau EUNETIPS, qui regroupe plusieurs sociétés savantes européennes engagées dans la prévention et le contrôle des infections. Si les problématiques sont fondamentalement similaires d’un pays à l’autre, les structures organisationnelles varient. Dans des systèmes fédéraux comme l’Espagne, l’Allemagne ou l’Italie, chaque région peut disposer de sa propre politique sanitaire, et parfois de sa propre société savante. Ces échanges sont donc essentiels pour confronter nos approches, les enrichir et améliorer la prévention du risque infectieux à une échelle plus large. D’ailleurs, en agissant au niveau national, et en rassemblant des professionnels médicaux et paramédicaux, la SF2H se distingue en Europe par son organisation unique, qui constitue une véritable richesse.
> Article paru dans Hospitalia #69, édition de mai 2025, à lire ici